Favoriser la biodiversité fait partie du métier d'agriculteur - elle est indissociable de la culture.
(VL) La biodiversité - que signifie-t-elle pour un maraîcher ? Et qui est responsable de sa préservation ? Pour répondre à ces questions, nous avons rendu visite à Samuel Kessens sur son exploitation maraîchère dans le canton d'Argovie. Entre pois et mauves, orties et tomates, le co-exploitant nous a montré à l'aide d'exemples concrets ce que la biodiversité signifie pour lui, comment il la favorise et ce que les personnes qui ne sont pas elles-mêmes actives dans l'agriculture peuvent faire pour elle. Autant dire d'emblée que, selon l'agronome, la préservation de la biodiversité n'est pas l'affaire des seuls agriculteurs - nous pouvons tous y contribuer. Découvrez dans l'interview du maraîcher non seulement l'avis d'un producteur sur le débat qui s'annonce sur la biodiversité, mais aussi où il voit les limites mais aussi les possibilités du système agricole actuel et ce que nous pouvons tous faire concrètement.
Text: Annalena Tinner Fotos: Tina Steinauer
PDF Lesen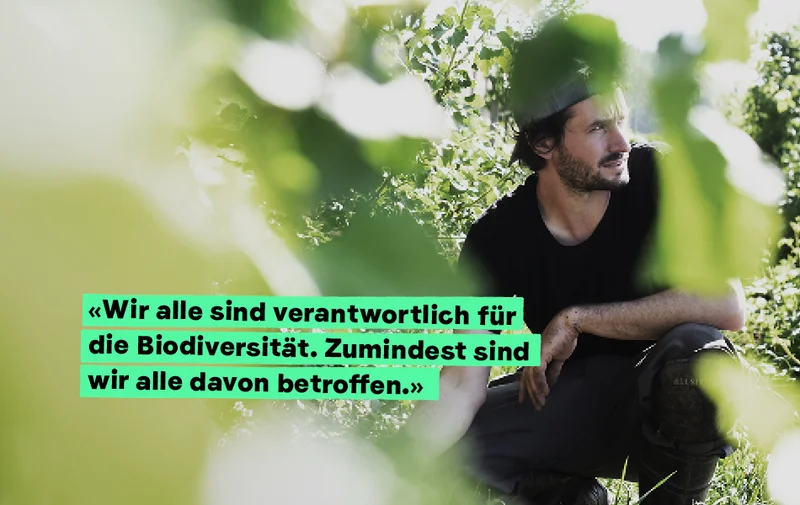
Il y a une légende ici
La biodiversité se trouve au milieu du champ et est indispensable à la production, affirme Samuel Kessens. L'agronome dirige une exploitation maraîchère à Oberwil-Lieli, dans le canton d'Argovie, en tant que co-chef d'exploitation.
Gabrielle D'Angelo et Annalena Tinner de Vision Landwirtschaft ont visité l'exploitation et se sont fait présenter le point de vue du producteur de légumes sur le débat à venir sur l'initiative biodiversité.
Samuel, la biodiversité et sa préservation feront l'objet d'une votation populaire nationale cet automne. Que signifie la biodiversité pour toi en tant que maraîcher ?
Pour moi, c'est l'assurance de pouvoir encore produire des légumes l'année prochaine et l'année d'après. Car je suis tributaire de la pollinisation de mes plantes et de la vie de mon sol. Et pour cela, j'ai besoin de la biodiversité. Car ce n'est qu'ainsi que je peux produire des plantes et des légumes sains. Si elle continue à diminuer aussi fortement, c'est un danger pour moi en tant que maraîcher.
Et pourquoi devons-nous les protéger maintenant ?
En fait, nous aurions dû agir il y a dix ans déjà (rires). C'est pourquoi c'est certainement encore le meilleur moment possible pour préserver la biodiversité et assurer l'existence des petites exploitations.
Selon toi, qui est responsable de la biodiversité ?
Nous sommes tous concernés. Du moins, nous sommes tous concernés. Certes, les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables, mais ils le sont aussi. Aucun agriculteur ne peut se soustraire à ses responsabilités en disant que c'est au consommateur ou au grand distributeur de le faire. Nous, les agriculteurs, pouvons dire "nous exploitons des terres, c'est pourquoi nous pouvons agir plus rapidement".
Mais aujourd'hui, seuls 3% de la population travaillent dans l'agriculture - comment tous ces gens qui n'ont pas accès à la terre peuvent-ils assumer leurs responsabilités ?
Très clairement dans leur comportement de consommation. Là, l'influence est énorme. Lorsque tu achètes des aliments, tu peux décider de la manière dont ils sont produits. Il est donc très important que les personnes qui ne sont pas actives dans l'agriculture soient conscientes de leur pouvoir. En veillant à la régionalité, à la saisonnalité et surtout à la petite échelle. Et si le consommateur connaît même l'exploitation d'où proviennent les légumes, c'est idéal.
L'exiguïté du territoire - qu'entends-tu par là ?
À petite échelle, cela signifie que nous cultivons beaucoup de choses différentes sur une petite surface et que nous prenons différentes mesures de promotion de la biodiversité. Car la diversité nous donne de la stabilité. Une grande exploitation qui ne vit que de quelques cultures est beaucoup plus exposée aux risques. Dans les exploitations diversifiées à petite échelle, la perte d'une variété n'a pas autant d'importance. En outre, nous ne produisons pas seulement des légumes, mais nous souhaitons également favoriser la diversité des organismes utiles, qu'il s'agisse d'oiseaux de proie, de mammifères ou d'organismes vivant dans le sol.
Tu as un exemple ?
Notre approche consiste toujours à travailler avec la nature. Nous essayons d'apporter cette diversité de la nature sur le terrain. Par exemple, chaque printemps, nous avons le problème des pucerons. La coccinelle est un bon adversaire en tant qu'auxiliaire. Nous avons constaté que la pression des ravageurs est moindre sur les surfaces séparées par des haies. Les haies servent de refuge aux coléoptères pendant l'hiver. Ainsi, au printemps, les coléoptères sont plus rapidement présents et dévorent plus facilement les pucerons.
Je ne pense pas que la production doive céder la place à la biodiversité.
Mais cette haie ne t'enlève-t-elle pas de la surface sur laquelle tu pourrais produire ?
Non, je ne vois pas ce problème. D'une part, la haie a un effet positif sur le rendement de la culture maraîchère. D'autre part, la haie peut être aménagée de manière à générer un avantage économique ; nous avons beaucoup d'arbustes à baies et d'arbres fruitiers dans nos haies, dont nous pouvons également récolter et vendre les fruits. Je ne pense pas que la production doive céder le pas à la biodiversité, car nous risquons de produire encore moins si la biodiversité continue à diminuer.
Tout cela semble positif. N'y a-t-il pas de défis dans ce système ?
Mais, dans cette petite échelle, nous avons toujours des ravageurs, car sans ravageurs, il n'y a pas d'auxiliaires. Nous devons simplement avoir confiance dans le fait que les mesures que nous avons prises à l'avance pour favoriser ces auxiliaires seront effectivement efficaces lorsque les ravageurs arriveront. Prenons l'exemple des campagnols : le fait d'avoir installé à l'avance des perchoirs pour les rapaces ou d'avoir construit un terrier de belettes sont des mesures possibles. Et lorsque les campagnols arrivent, il faut un certain temps pour que les insectes utiles arrivent aussi. C'est surtout cette phase de transition qui est difficile à supporter pour les agriculteurs. Mais un système global intact régule ensuite la situation de manière à ce que les dégâts restent finalement gérables.
Alors pourquoi toutes les entreprises ne produisent-elles pas comme vous le faites ?
Les exigences des acheteurs constituent un gros problème pour les autres maraîchers. Si tu produis pour le commerce de gros, tu ne peux pas produire de manière aussi diversifiée que nous le faisons ici. Car le grand distributeur veut des chaînes de livraison simples ; il veut toutes les carottes d'une exploitation et toutes les tomates d'une autre - et non pas 20 ou 30 sortes de légumes différents en très petites quantités de chaque exploitation. Si tu livres au grand distributeur, tu ne peux guère, dans le système actuel, cultiver à petite échelle et de manière vraiment respectueuse de la biodiversité.
Surfaces de biodiversité
La population suisse travaille actuellement dans l'agriculture. Comment toutes ces personnes, qui n'ont pas accès à la terre, peuvent-elles donc assumer leurs responsabilités ?
La surface de l'exploitation de Biogarten Lieli est constituée de surfaces de promotion de la biodiversité, dont la majorité sont des haies.
As-tu le sentiment que l'agriculture suisse en fait généralement assez pour la biodiversité ?
Non, pas encore. Nous pourrions avoir une agriculture beaucoup plus durable et passionnante. Mais je pense aussi que les conditions-cadres ne sont pas idéales et c'est pourquoi il n'y a pas encore autant d'exploitations qui ont pris ce train de la biodiversité.
Comment les conditions-cadres devraient-elles être modifiées ?
Si, en tant qu'agriculteur, tu as peur de perdre des terres parce que tu ne peux plus produire, cela cache avant tout une peur économique. Mais cette peur peut être levée en leur garantissant des prix plus élevés pour les produits. Ceci est à son tour surtout lié à des décisions politiques, par exemple des restrictions d'importation. Mais ce sont des choses que les agriculteurs ne décident pas eux-mêmes. En principe, de nombreux agriculteurs ont besoin de prendre du plaisir dans leur travail et d'essayer de nouvelles choses. Le travail reste ainsi passionnant. Et si cela ne représentait pas un grand risque financier, de nombreux agriculteurs suivraient cette voie et pourraient être plus innovants.
Dans l'agriculture, un chef d'exploitation doit déjà avoir de nombreuses connaissances sur la gestion de l'entreprise, le comportement sur le marché, l'entretien des machines, la culture des légumes et les maladies des animaux. Et voilà qu'un nouveau thème vient s'ajouter à la biodiversité - n'est-ce pas trop ? Est-ce vraiment le rôle de l'agriculture de s'occuper en plus de la biodiversité ?
Bien sûr, des services de conseil seraient peut-être déjà utiles, dans la formation, le sujet n'est qu'effleuré. Mais en tant qu'agriculteur, je vois la valeur de la biodiversité et il est donc évident que je m'en occupe aussi. Si la biodiversité est la raison d'un rendement élevé - et c'est bien le cas - alors tu dois t'en occuper activement, ce n'est pas un domaine secondaire qui peut être externalisé. La biodiversité n'est pas simplement la bande fleurie à côté du champ de légumes et c'est tout. Elle a lieu au milieu du champ. Favoriser la biodiversité fait partie intégrante du métier d'agriculteur - elle est indissociable de la culture.
Revenons à l'initiative. L'initiative demande plus d'espace pour la biodiversité, cette condition est-elle justifiée ?
Je ne vois pas cela comme une obligation, mais plutôt comme une chance pour les agriculteurs. Le fait que nous puissions - parce que c'est prescrit - utiliser des surfaces pour la biodiversité. Car sans biodiversité, nos exploitations ne fonctionnent pas. Ce qui me plaît dans cette initiative, c'est qu'elle demande une approche globale de la société. Que nous, les agriculteurs, soyons soutenus, que nous ne soyons pas les seuls responsables, mais que nous fassions tous quelque chose pour cela, y compris l'agriculture. Oui, l'initiative est à mon avis justifiée.
L'entreprise
La ferme biologique Lieli, une exploitation maraîchère de 14 hectares, se trouve à Oberwil-Lieli et est gérée selon les directives biodynamiques. Environ 60 variétés de légumes sont produites à la ferme sur de petites surfaces et parviennent directement à la clientèle par le biais d'abonnements de légumes ou de stands de marché. Cette production variée nécessite une exploitation à petite échelle et, par conséquent, beaucoup de travail manuel,
Ce travail est effectué par une trentaine d'employés. Ce travail manuel permet toutefois de récolter plusieurs fois par an sur chaque surface et d'obtenir un rendement plutôt élevé. Environ 10% de la surface de l'exploitation sont des surfaces de promotion de la biodiversité, dont la majorité sont des haies.
Faits
La protection phytosanitaire dans la culture maraîchère de plein champ est exigeante, car de nombreuses cultures de légumes sont sensibles aux maladies et aux ravageurs. A cela s'ajoutent des exigences de qualité élevées de la part du commerce et des consommateurs. C'est pourquoi la plupart des cultures maraîchères utilisent nettement plus de pesticides que les grandes cultures telles que les céréales, les betteraves sucrières, etc. Des mesures ciblées, généralement préventives, permettent toutefois de réduire l'utilisation de pesticides et les risques environnementaux qui y sont liés. Parmi ces mesures préventives, on trouve notamment une rotation des cultures bien pensée, le choix d'un site approprié, la garantie d'une bonne fertilité du sol ainsi que la recherche d'une date de semis et de plantation optimale. En outre, l'utilisation de variétés résistantes ou tolérantes aux ravageurs et adaptées au site est une mesure décisive pour minimiser l'utilisation de produits phytosanitaires.
De nos jours, les monocultures à grande échelle dominent la culture des légumes en plein champ. Mais ces surfaces de culture uniformes ont l'inconvénient de permettre aux champignons et aux insectes nuisibles de se multiplier facilement et de menacer toute la récolte en cas d'attaque. Une alternative possible à ce système de culture traditionnel est la culture à petite échelle. Dans ce cas, plusieurs espèces ou variétés différentes sont plantées les unes à côté des autres. Les espèces complémentaires ne se font pas concurrence, mais peuvent par exemple rendre le sol plus fertile pour l'autre espèce, éloigner les insectes nuisibles ou attirer les parasites pour soulager l'autre plante, ou encore freiner la croissance des mauvaises herbes (Agroscope 2020).
Les avantages d'une culture mixte sont
- Rendement total plus élevé par surface en raison d'une répartition optimale de l'espace
- Tenir les ravageurs à distance grâce à l'odeur dérangeante de la plante voisine
- Lutter contre les ravageurs grâce aux auxiliaires des plantes voisines
- Moins d'engrais nécessaire
- Plus grande diversité des espèces
- Différentes hauteurs de croissance ombragent le sol et la plante voisine
Les cultures mixtes sont toutefois encore peu expérimentées dans la culture maraîchère et donc peu visibles dans les terres agricoles. De plus, l'utilisation de machines dans les cultures mixtes est plus difficile et nécessite davantage de travail manuel. Malgré tout, les quelques exploitations maraîchères pratiquant les cultures mixtes montrent qu'il est possible de pratiquer également la culture maraîchère sans pesticides tout en restant rentable.






