Il faut une vision globale du système agroalimentaire
(VL) Les arbres à haute tige sont bons pour l'environnement et pour l'homme, c'est pourquoi ils sont soutenus par des paiements directs. Malgré cela, la plupart des agriculteurs sont heureux d'avoir le moins de rendement possible. En effet, dans la plupart des cas, il n'est pas rentable de ramasser les fruits et de les transformer en cidre. C'est un bon exemple de la situation dans laquelle nous nous trouvons avec la rémunération des prestations d'intérêt général. Il faut faire évoluer le système des paiements directs vers une transformation du système alimentaire. La PA 30+ offre des opportunités à cet égard.
Text: Vision de l'agriculture Fotos: Réseau Vision Landwirtschaft
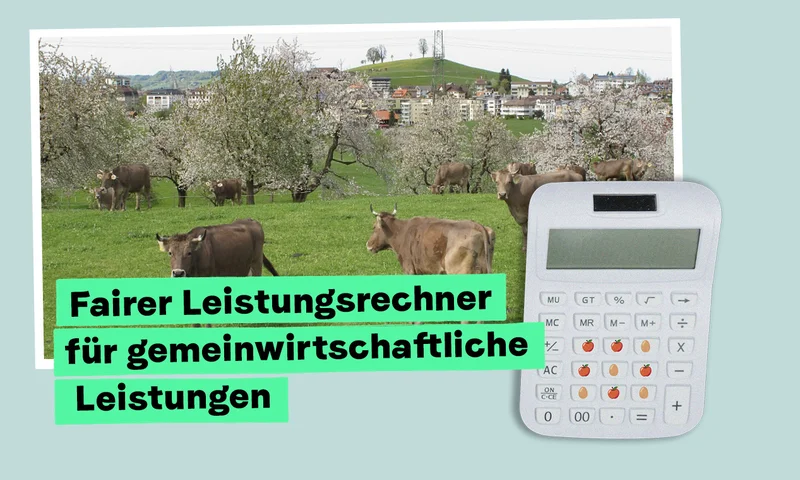
Calculateur de prestations de service public
Les arbres fruitiers haute-tige sont un élément important pour la nature et la protection des espèces. Ils servent d'habitat aux insectes et aux oiseaux. Comme ils perdent de plus en plus leur importance économique, les surfaces se réduisent toutefois malgré les efforts de protection. Leur maintien entraîne des frais d'entretien élevés qui ne sont pas rentabilisés par les produits vendus. Les prix à la production sont restés inchangés depuis 30 ans, rapporte l'association Hochstammobstbau. En revanche, les coûts ont augmenté. Les prix indicatifs pour les pommes à cidre (Suisse garantie) sont de 27 centimes/kg et pour les pommes à cidre (Bio) de 33 centimes/kg.. S'il n'y a rien à gagner avec les fruits à cidre, les pommes et les poires à cidre restent sur le sol et les arbres à haute tige disparaissent peu à peu de notre paysage. Les coûts pour les cidreries ont également énormément augmenté. Plus les étapes du processus industriel sont nombreuses (concentration et séparation des molécules de goût), plus les coûts énergétiques sont élevés.
Selon les calculs de la cidrerie Möhl, les producteurs reçoivent 55 centimes/kg, si les paiements directs sont pris en compte. Un prix de 80 centimes/kg serait équitable.
Quel avenir pour le système des paiements directs ?
Malgré tout, les paiements directs ont aussi permis de réaliser beaucoup de choses : une stabilisation des revenus des exploitations agricoles et le maintien de nombreuses prestations écologiques qui sont d'une grande valeur pour nous tous. L'exemple des arbres haute-tige montre toutefois que le système des paiements directs comporte encore des lacunes et des erreurs. Du point de vue de la société dans son ensemble, l'évolution des arbres haute-tige est alarmante : l'argent du contribuable est utilisé pour que les arbres haute-tige soient en place, mais au final, il en résulte un "foodwaste", car le travail d'entretien et de récolte n'est pas indemnisé. Avec le Rapport de postulat a défini la direction dans laquelle le système doit évoluer. Il s'agit maintenant de trouver des instruments et des solutions concrètes. Il faut des solutions qui associent la biodiversité, la production, la protection du climat et l'économie. Et il faut des solutions qui intègrent l'ensemble du système alimentaire. Actuellement, toutes les mesures se concentrent sur la loi sur l'agriculture et donc sur les exploitations individuelles. Or, la charge administrative et la complexité croissante se heurtent aux limites de la faisabilité. C'est pourquoi de nouveaux instruments sont nécessaires.
De nouvelles possibilités : Calculateur de prestations comme exemple
Un moyen possible de rendre les prestations de service public tangibles pourrait être le Calculateur de performance des valeurs régionales être. Le calculateur, déjà utilisé dans la pratique en Allemagne, est d'abord utilisé en Suisse dans un cadre expérimental. Dans un catalogue de plus de 500 chiffres-clés, une ferme peut saisir les prestations qu'elle fournit et obtenir ainsi une valeur monétaire pour les différentes prestations ainsi qu'une somme pour l'ensemble de l'exploitation.
Les indicateurs sont grossièrement répartis entre les trois piliers de la durabilité : l'écologie, l'économie et le social. Par rapport aux paiements directs, le calcul de la durabilité du calculateur de prestations ne mesure donc pas seulement les avantages pour la nature, mais aussi les conditions de travail des employés et l'impact des activités agricoles sur l'homme.
L'agriculteur Bruno Stadelmann est l'un de ceux qui ont calculé leur exploitation à l'aide du calculateur de rendement. Ce spécialiste de la volaille gère avec sa femme une exploitation de 12 ha. Ferme à Willisau (LU). Outre les poules pondeuses comme activité principale, ils élèvent quelques vaches mères et des arbres à haute tige. Stadelmann n'est pas seulement un homme qui met la main à la pâte, c'est aussi un cérébral qui réfléchit. Il raconte que, tout en travaillant de ses mains et en s'occupant des animaux, il nourrit sa tête de nouveaux apports, en écoutant par exemple des émissions de radio sur l'agriculture. Stadelmann a appris l'existence du calculateur de rendement par un podcast en Allemagne et, par curiosité, il a utilisé la version suisse pour son exploitation. La curiosité a été suivie par l'enthousiasme. Non seulement sur la structure pratique du calculateur, mais aussi sur le fait qu'il lui permette d'obtenir un chiffre concret pour les prestations d'intérêt général qu'il fournit. "Nous avons enfin une valeur dont nous pouvons parler en termes clairs", déclare Stadelmann.
Ce qui lui plaît particulièrement dans le calculateur de performance, c'est que l'économie régionale et la durabilité sociale sont prises en compte. Des questions comme : Les produits sont-ils revendus au niveau régional plutôt qu'au grossiste, les collaborateurs sont-ils rémunérés de manière équitable ou l'exploitation forme-t-elle aussi des apprentis et ne travaille-t-elle pas simplement avec une main-d'œuvre bon marché ? "Pour les paiements directs, tout cela n'est pas pertinent, seule la durabilité écologique est prise en compte", explique Stadelmann. Il critique en outre le fait que les paiements directs soient soumis aux mêmes exigences dans toute la Suisse ; qu'il s'agisse d'une exploitation de montagne au Tessin ou d'un maraîcher à Schaffhouse, d'une exploitation laitière en Appenzell ou d'une exploitation avicole dans le Jura ; tous doivent remplir des exigences très similaires, la marge de manœuvre n'est plus grande - et l'utilité non plus, malheureusement. Ces fermes sont trop diverses, le système qui les décrit est trop uniforme.
Raphael Felder, directeur de l'Union des paysans lucernois, voit lui aussi des opportunités dans un instrument tel que le calculateur de prestations. Si un tel outil était introduit, les chefs d'exploitation pourraient choisir de manière beaucoup plus flexible parmi un ensemble de prestations adaptées à leur exploitation et, tout compte fait, apporter une meilleure contribution à la société.
L'idée est que chacun devrait fournir une base de prestations et pourrait ensuite optimiser sa propre exploitation en termes de durabilité à l'aide de modules flexibles, en fonction de sa situation et de sa ferme. Par exemple, une exploitation proche de la ville pourrait fournir davantage de prestations dans le domaine de la transmission des connaissances, tandis qu'une exploitation de montagne pourrait plutôt fournir des prestations en matière de durabilité dans le domaine de la promotion de la biodiversité.
Lancement d'un concours d'idées : Système d'indicateurs de l'ASSAF
La révision totale présente d'autres défauts :
Ainsi, il n'y aurait toujours pas d'examen des effets des PPP sur les amphibiens, les champignons aquatiques, les abeilles sauvages et autres insectes pollinisateurs. Selon l'article 10 de la nouvelle OPPM, il serait même possible d'autoriser en Suisse des substances actives qui ne sont pas autorisées dans l'UE. Cela comporte des risques considérables. Par exemple, les néonicotinoïdes, extrêmement toxiques pour les insectes pollinisateurs, pourraient être à nouveau autorisés si l'OFAG cédait à la pression du lobby agricole.
Qui prend en charge les frais ?
Pour Stadelmann, il est clair qu'une partie des valeurs calculées par le calculateur de prestations est déjà couverte par le système actuel des paiements directs - et cela pourrait rester ainsi avec certaines adaptations. Le calculateur de prestations offre plus de transparence sur ce qui est fourni à la base de notre chaîne alimentaire, il montre les prestations effectivement fournies. Il ne suffit pas de dire que nous sommes bons et que nous faisons beaucoup, nous avons besoin d'un instrument qui nous permette de communiquer nos prestations. Le calculateur de prestations ne fournit cependant pas de chiffres concrets pour les coûts et les prestations qui sont générés dans l'ensemble du système alimentaire, pour la production en aval, pour le revendeur et pour le consommateur. Le calculateur de prestations a été développé pour mettre en évidence les prestations de l'agriculture. Les valeurs ont été élaborées dans le cadre d'un large dialogue avec tous les groupes d'intérêts. C'est aussi pour cette raison que sa structure est simple et que la charge administrative est raisonnable. "Pour que le changement de système soit une réussite", souligne Felder, "la charge administrative ne doit pas être importante". Et pour l'agriculteur Bruno Stadelmann, une chose est claire : "Je souhaite un système qui reflète nos prestations sociales, qui soit construit en fonction de la pratique et qui me soutienne dans mon autonomie de chef d'exploitation".
Il faut des objectifs clairs pour la transformation
Et pour en revenir à notre exemple des arbres à hautes tiges, financer des mesures écologiques sans intégrer le développement écologique dans la chaîne de valeur ajoutée conduit à des pommes à cidre qui restent au sol et constituent au mieux une nourriture pour les oiseaux, les petits mammifères ou les insectes. Dans le système actuel, la production végétale et les prestations écologiques et sociales de l'agriculture ne sont pas suffisamment rémunérées. Cela doit changer. Les nombreux efforts déployés par le secteur et l'ouverture de nombreux agriculteurs à l'égard de nouveaux systèmes et d'une évolution vers une plus grande orientation vers des objectifs dans le système des paiements directs sont encourageants.
Pour que la transformation soit un succès, il faut toutefois que tous les acteurs du système alimentaire soient impliqués. Ce n'est pas seulement l'agriculture qui porte la responsabilité de la réussite, mais tous les acteurs du système : les producteurs, les transformateurs, le commerce de détail et les consommateurs. Pour cela, il ne suffit pas que les acteurs concernés aient la volonté d'aller de l'avant, il faut aussi que la Confédération définisse clairement des objectifs valables pour l'ensemble du système alimentaire. Cela peut prendre la forme de taxes d'incitation ou d'une convention d'objectifs, comme par exemple un contingent minimum de produits répondant à un standard écologique minimal.
Nous avons besoin d'un modèle qui fixe des règles contraignantes pour l'ensemble du système alimentaire. Pour que les pommes ne restent pas dans le pré et que l'on puisse ainsi continuer à produire des denrées alimentaires en Suisse tout en fournissant avec succès des prestations d'intérêt général pour la protection de nos écosystèmes.
